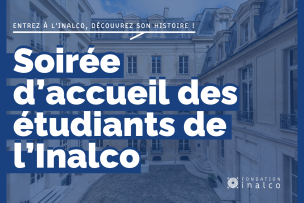Une histoire riche

Dates clés
1795 Création de l’École spéciale des langues orientales
1873 L'École s'installe 2 rue de Lille, Paris 7e
1914 L’École change de statut et devient École nationale des langues orientales vivantes (Enlov), elle adopte le surnom de Langues O’
1971 L’École devient l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)
1984 L’Inalco acquiert le statut de grand établissement
2010 L’Inalco est membre fondateur de Sorbonne Paris Cité
2011 L’Inalco installe l’ensemble de ses formations en un lieu unique au 65 rue des Grands Moulins, Paris 13e
2021 La Maison de la recherche de l'Inalco est inaugurée au 2 rue de Lille, Paris 7e
La création de l'Inalco
La création de l'Inalco
Au moment de la Révolution française, la volonté est d’avoir un établissement français complémentaire du Collège de France voué aux langues vivantes dont la finalité sera dirigée vers « les idiômes vulgaires et diplomatiques ». Le rapport de Lakanal à la Constituante est explicite : « l’utilité publique et commerciale doit seule nous guider dans le choix des langues orientales à enseigner ».
En 1795 ; il y avait une pénurie d’interprètes dans un temps où le commerce et la diplomatie constituaient des éléments stratégiques dans la diffusion des idées révolutionnaires. Il devenait donc urgent de mettre en place une institution chargée de préparer de la manière la plus adéquate des français à la connaissance des langues vivantes jugées utiles par la Convention. Ainsi, au moment le plus critique de la Terreur, l’assemblée des représentants du peuple français vote la charte constitutive de l’Inalco le 10 germinal an III.
Aux termes du décret de fondation, l’Ecole des langues orientales vivantes est « destinée à l’enseignement des langues d’une utilité reconnue pour la politique et le commerce » ; le décret porte en outre qu’elle sera établie dans l’enceinte de la Bibliothèque nationale, afin de pouvoir disposer des ressources scientifiques nécessaires à cet apprentissage.
Un développement institutionnel et linguistique
Un développement institutionnel et linguistique
L’École est ouverte avec trois chaires : l’une d’arabe vulgaire et littéral, la seconde de turc et de tartare de Crimée, la troisième de persan et de malais. Les évènements ne tardent pas à montrer quels services importants l’État peut attendre de la nouvelle institution. Trois ans à peine après le décret du 10 germinal, l’un des professeurs de l’École, Venture de Paradis, part comme interprète en chef de l’armée d’Égypte, emmenant avec lui ses meilleurs élèves.
Au vu des succès obtenus par ces derniers, le but poursuivi par la Convention et continué par le Directoire a été atteint puisque l’École s’est mise rapidement en mesure de pourvoir aux besoins pour lesquels elle a été créée. Afin d’y parvenir, l’École n’hésite pas à faire évoluer son institution, à demander des locaux en adéquation avec son enseignement et à augmenter sans cesse le nombre des langues orientales.
- Au cours du XIXe et du XXe siècles, le statut de l’École est modifié à plusieurs reprises, lui permettant d'asseoir sa spécificité dans un contexte politique favorable à son expansion. L’ordonnance royale du 22 mai 1838 consiste à faire entrer autant que possible l’École des langues orientales dans les cadres universitaires. Le décret du 8 novembre 1869 procède à la réorganisation de l’École afin de se conformer à la « destination primitive » : toutes les prescriptions tendent à imprimer une direction plus pratique aux études sans porter atteinte au caractère scientifique de l’enseignement. L’École doit marier d’une manière subtile son rôle d’établissement de haute science qui l’a fait connaître en Europe et sa mission à former des élèves capables de remplir les difficiles fonctions d’interprètes dans les pays orientaux. Enfin, le statut du 8 juin 1914 confirme les orientations précédentes et accorde à l’École le titre de « grand établissement d’enseignement supérieur ».
- Pendant près de 70 ans, l’École se contente pour sa mission d’enseignement d’un petit local de la Bibliothèque nationale mis à sa disposition. Or, à la faveur de l’Exposition universelle de 1867, l’École acquiert ou reçoit en don un nombre considérable d’ouvrages orientaux et quelques documents ethnographiques. Il devient donc impossible de trouver de la place pour cet accroissement de ressources dans l’étroit espace concédé à l’administration de l’École. Quittant définitivement la Bibliothèque nationale en 1868, l'École s’installe provisoirement dans les appartements de l’administrateur du Collège de France, avant de recevoir en 1873 par décret du Président de la République un ancien hôtel particulier sis au 2, rue de Lille à Paris. De nombreux travaux sont réalisés au cours de la décennie 1880 afin de donner un écrin institutionnel et symbolique aux missions d'enseignement de l’École.
- Quatre langues orientales sont fixées par le décret de l'An III, une cinquantaine de langues sont inscrites au programme des études de 1969-1970 : l’enseignement de la diversité des langues orientales est en marche.
L'explosion numérique et géographique
L'explosion numérique et géographique
L'enseignement supérieur français rencontre des nombreuses problématiques auxquelles l'École est également confrontée (augmentation vertigineuse du nombre d'étudiants, manque de professeurs, espaces d'enseignement insuffisants, modalités d'apprentissage désuètes). Les événements de 1968 entraînent donc une modification significative des structures institutionnelles et des pratiques de l'enseignement.
La conséquence institutionnelle se manifeste par le changement de nom de l’École, qui devient en 1971 l’Institut national des langues et civilisations orientales, ainsi que par son rattachement à l’université Paris Sorbonne.
La très forte augmentation des effectifs, conjuguée à l’insuffisance spatiale du bâtiment historique de la Rue de Lille, entraîne l’éclatement géographique des missions d’enseignement. Dès 1968, certains cours sont dispensés « provisoirement » dans les bâtiments laissés libres par l’OTAN à la Porte Dauphine, puis en 1969 d’autres cours sont installés au centre universitaire de Clichy, et en 1971 au centre universitaire d’Asnières. Dès lors, l’Inalco est sans cesse à l’affût de locaux tampons, temporaires, lui permettant d’assurer ses missions d’enseignement.
Une unité historique et collaborative
Une unité historique et collaborative
Bien que le rattachement à l’université Paris Sorbonne Nouvelle ait apporté des avantages certains au fonctionnement administratif de l’Inalco, les différences identitaires ne tardent pas à rendre inévitable l’autonomie de l’Inalco. Grâce à la loi Savary de 1984, l’Institut est classé parmi les « grands établissements » indépendants.
Après avoir retrouvé un statut institutionnel, la bataille ultime de l’Inalco réside dans l’obtention du regroupement géographique de ses enseignements. Plusieurs projets immobiliers n’aboutissent pas. Il faut attendre la décennie 2000 pour voir émerger le projet du Pôle des langues et civilisations intégrant dans un bâtiment unique l’Inalco dans sa mission d’enseignement et la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations. Ce système immobilier fonctionne depuis septembre 2011.

Le cycle de récits qui vous plonge dans l'histoire de l'Inalco

En savoir plus sur le site historique de l'Inalco