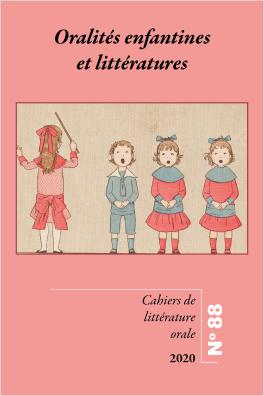
Cahiers de littérature orale
Contenu central
Les Cahiers de littérature orale, revue rattachée au LLACAN UMR 8135 (CNRS et Inalco) est l’une des rares publications en langue française exclusivement consacrée aux textes transmis oralement.
Chaque cahier (environ 220 pages, deux numéros ou un double par an) est articulé autour d’un thème relatif aux différentes facettes de l’oralité. Il rassemble des discussions, des articles de fond, des comptes rendus et diverses informations.